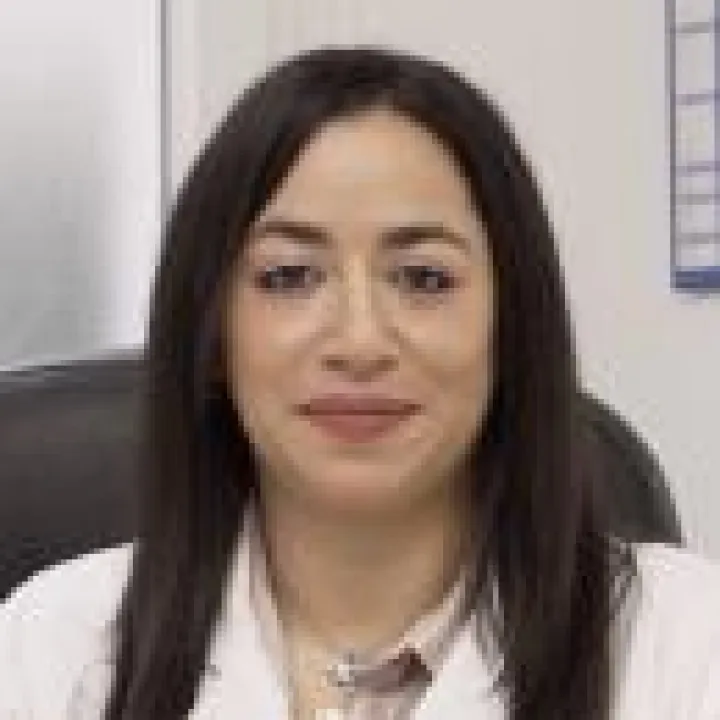Dahlia Tharwat, sage-femme, a consacré son doctorat en Psychologie de la santé et en Neurosciences aux "mécanismes de la dépression post-natale (DPN) et aux facteurs de protection/prévention tels que la Mindfulness" à l’université de Lorraine/IRBA (Institut de recherche biomédicale des Armées), afin d’en améliorer la prévention, le dépistage et la prise en charge.
Pour ce faire, elle a notamment développé un programme de formation pour les professionnels de santé axé autour de l'immersion en #RéalitéVirtuelle.
Dans cette vidéo, Dahlia Tharwat revient sur les objectifs de sa thèse et ses apports pour la recherche :
Entretien avec Dahlia THARWAT
Sage-femme à la maternité des Diaconesses (Paris), Dahlia Tharwat réalise une thèse en Psychologie de la santé et en Neurosciences consacrée aux "mécanismes de la dépression post-natale (DPN) et aux facteurs de protection/prévention tels que la Mindfulness" à l’université de Lorraine/IRBA (Institut de recherche biomédicale des Armées) sous la direction de Marion Trousselard, médecin chef des services et co-directrice de l’unité de neurophysiologie du stress. Aux côtés d’autres sages-femmes, Dahlia Tharwat est par ailleurs co-fondatrice d’une application consacrée à la santé des femmes, baptisée Santeac, qui aborde une large gamme de thématiques, depuis la contraception jusqu’à la grossesse et l’accouchement, en passant par la ménopause et l’endométriose.
Comment la dépression post-natale est-elle prise en charge en France ?
Malheureusement, il n’existe aujourd’hui ni protocole national, ni consensus, sur la prise en charge de la dépression post-natale (DPN). Pour beaucoup de femmes, elle n’est d’ailleurs même pas diagnostiquée, car elles n’ont jamais entendu parler du risque de DPN et en ignorent tout : peu de professionnels de santé l’évoquent. Les femmes concernées mettent donc leurs symptômes sur le compte de la fatigue post-accouchement et ne consultent pas systématiquement de professionnel de santé.
Les soignants de la périnatalité, de leur côté, sont souvent bien mal formés. Et dans ce cas, ils n’utilisent pas les outils à leur disposition, comme le questionnaire Edimbourg – un instrument privilégié de dépistage de la DPN. Enfin, quand une DPN est malgré tout dépistée, la sage-femme, l’obstétricien ou le généraliste en question renvoient vers la PMI ou vers une psychologue. Autrement dit, la prise en charge de cette pathologie, dans notre pays, relève du cas par cas : elle n’est pas homogène.
C’est d’autant plus regrettable qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique. Le risque d’une DPN concerne en effet 15 % à 20 % des femmes après l’accouchement – et si cette maladie n’est pas traitée, elle risque de se convertir en dépression chronique ! Le risque s’élève même à 40 % chez les femmes militaires ou les femmes dont les conjoints sont militaires (selon des données anglo-saxonnes) – c’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’IRBA appuie ma recherche. Appliquée à la population militaire et civile, mon étude a aussi pour but de déterminer s’il existe un lien entre dépression post-natale et stress chronique.
D’où provient, à votre avis, le manque de formation des soignants ?
J’ai pris conscience de ce manque de formation il y a un an environ, quand j’ai dirigé le mémoire d’une étudiante sage-femme, Laurine Lebossé, qui travaille désormais à la maternité des Diaconesses. Sa recherche portait sur "les complications psychiques du postpartum, évaluation des pratiques professionnelles". Nous avons ainsi constaté que les connaissances des soignants étaient très floues : amalgame entre le baby-blues – d’origine physiologique et limité dans le temps – et la DPN ; confusion entre complications bénignes et malignes de la DPN ; banalisation fréquente de la dépression… Cela étant, les soignants étaient unanimes à demander des formations dans le domaine, et des outils de dépistage.
Pourquoi cette méconnaissance ? D’abord, la DPN a longtemps été considérée comme un problème secondaire, aussi peu de temps y est-il accordé durant la formation des soignants. Ainsi, le volet « complications psy » post-accouchement n’a occupé que quelques heures durant ma formation de sage-femme – ces complications, je les ai surtout vues ensuite, durant ma pratique. Pour les médecins, le manque de connaissances provient aussi du manque de temps durant leurs études, déjà très denses. Enfin, il est possible que ce désintérêt soit le signe d’un machisme résiduel : après tout, ce sont des problèmes de femme !
À cet égard, l’édition du rapport Les 1000 premiers jours, par le ministère des Solidarités et de la Santé, en septembre 2020, me semble un excellent signal : la DPN y est largement traitée. De fait, elle ne concerne pas que la mère : soigner la DPN, c’est aussi essentiel pour accompagner le développement neuro-moteur, psychologique et affectif de l’enfant.
Quels sont les principaux éléments du programme de formation que vous souhaitez proposer ?
J’aimerais mettre en place un outil théorique pour rappeler les bases, éviter les confusions entre les complications pathologiques et inoffensives, et donc permettre aux soignants d’identifier une DPN. Et, parallèlement, les sensibiliser à la prise en charge et aux traitements possibles. Pour la partie pratique, j’ai retenu l’immersion en réalité virtuelle, cet outil pédagogique permet une mise en situation au plus près de la réalité.
Parallèlement, j’aimerais mettre en place une campagne de prévention au niveau national, destinée cette fois aux mères et futures mères ainsi qu’à leurs proches, lesquels pourraient identifier des signaux d’alarme d’une DPN et en pareil cas, inciter la patiente à consulter un professionnel de santé.
Pourquoi recourir à la réalité virtuelle ?
Elle crée un sentiment de réalisme et améliore donc l’apprentissage. Cela peut être utile dès l’hôpital, pour des soignants constatant les difficultés psychiques d’une femme quelques semaines après l’accouchement.
En outre, comme la DPN survient deux mois à un an après l’accouchement, les soignants de ville qui y sont confrontés ne songent pas nécessairement aux suites de l’accouchement. La formation que je propose permettrait de leur mettre la puce à l’oreille.
Cette formation sera d’ailleurs ouverte aux sages-femmes, aux pédiatres, aux gynécologues, aux généralistes, aux infirmières et à tout professionnel de la périnatalité : plus le personnel soignant sera formé, plus une femme souffrant de DPN aura de chances d’être dirigée vers un psychologue ou un psychiatre à même de l’aider.
Enfin, le recours à la réalité virtuelle permet d’évaluer l’assimilation des connaissances théoriques.
Comment cette formation pourrait-elle être intégrée de manière routinière au cursus des sages-femmes et gynécologues-obstétriciens ?
Je l’envisage comme une formation supplémentaire, à l’instar de ce qui existe déjà, par exemple sur le risque incendie, les soins de développement du nouveau-né, les soins palliatifs etc. Elle pourrait être financée par les établissements de santé et proposés à tous les soignants de la périnatalité, y compris les professionnels de ville, en fin d’études ou début de carrière, une fois une certaine maturité acquise. Très concrètement, elle pourrait tout simplement être intégrée dans le dispositif du CPF (compte personnel de formation).